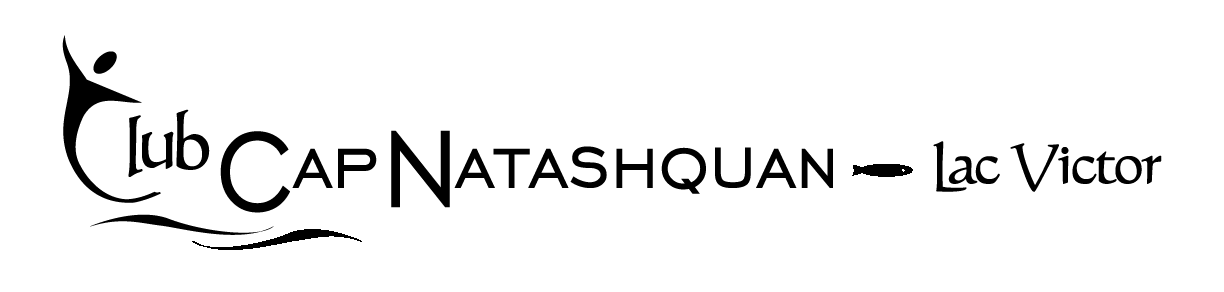« Avez-vous remarqué cette expression ; la Côte-Nord ? Elle revient souvent sous la plume de nos écrivains et de nos journalistes. Cependant c’est en vain que vous la chercherez sur la carte. Où donc se trouve-t-elle ? Si vous ouvrez votre géographie, vous constaterez que le Saint-Laurent coupe en deux notre province, l’une au nord, l’autre sud. Il y a donc une rive sud et une rive nord; c’est une partie de cette dernière qui est mieux connue sous le vocable de Côte-Nord. Mais pourquoi dire Côte-Nord au lieu de rive nord qui serait le terme véritable ? C’est qu’en considérant ces énormes falaises, on a tout de suite l’impression d’être non pas sur la rive d’un fleuve mais au bord de la mer. Et cette impression est encore fortifiée si l’on mesure l’étendue des eaux ; la rive sud est si lointaine qu’à peine peut-on l’apercevoir. D’ailleurs les gens de là-bas ne parlent jamais du fleuve : ils disent toujours la mer…Vous allez sans doute me demander : où commence-t-elle, cette Côte-Nord ?
Il est d’autant plus difficile de préciser, que ses limites ont changé au cours des âges. Elles ont reculé à mesure qu’avançait la colonisation. Avez-vous remarqué, en effet, que ce nom exhale comme un relent de sauvagerie, de pays non encore touché, un pays de solitude, je dirai presque un pays non encore découvert…
La Côte-Nord, à la fin du régime français, c’était donc cette partie de la côte qui va du cap Tourmente à l’embouchure du Saguenay.
Quant au pays au-delà, c’était une sorte de Terra incognita d’où seuls émergeaient quelques postes de pêche ou des comptoirs à fourrures, une sorte de pays désolé, dernier refuge de la sauvagerie et des indiens trappeurs. C’est pourtant cette région qui est devenue, aujourd’hui, la véritable Côte-Nord…Le Saguenay est donc maintenant la frontière qui garde la Côte-Nord.
Est-ce à dire que passé cette rivière, toute colonisation a cessé ? Que non pas. Les Bergeronnes, par exemple, renferment des fermes prospères. Mais reconnaissons-le, ce n’est là que l’exception, seule l’industrie vient animer le pays. Et encore, sur une bande étroite, large d’un mille à peine. En arrière, c’est toujours la forêt immense, sauvage, jusqu’aux solitudes glacées de l’extrême nord.
Cette forêt, la hache du bûcheron peut bien l’entamer, elle ne peut pas, elle ne doit pas l’anéantir, parce que pour bien des années encore, elle sera la seule source de travail et de richesse.
Sana doute, cette forêt n’est pas absolument vide, Indiens et trappeurs y errent à la poursuite des animaux à fourrure. Mais ils le font, comme l’ont fait leurs ancêtres, en nomades, allant d’un lieu à un autre, sans domicile fixe…Avant d’aller plus loin, il est bon de spécifier qu’il y a deux Côtes-Nord : celle dont nous avons parlé jusqu’ici et la grande côte nord ou comme on dit souvent : le Labrador, terre toute frissonnante, rude, âpre, stérile et sans aucune saveur de terre, selon la pittoresque expression de Jacques Cartier.
Est-ce à dire que cette Terre de Caïen est uniquement le partage des maudits ? Que non pas, elle a ses charmes aussi. L’abbé Ferland, qui l’a longuement parcourue, en parle avec amitié :
“Comme la Providence, par une admirable disposition, a réglé que le genre humain occuperait toute la surface de la terre, elle a donné aux lieux même les plus désolés, quelque chose qui arrête et retient. A chaque pays, à chaque climat, elle a attaché des avantages qui en contrebalancent les misères. Le Labrador a ses charmes, non seulement pour ceux qui y sont nés, mais encore pour ceux qui y ont vécu quelque temps. La mer avec l’abondance de son gibier aquatique, la richesse et la variété de ses pêcheries, avec ses jours de calme et de tempête, avec l’espace immense de ses horizons changeants ; la forêt avec ses chasses lointaines et aventureuses : tout cela quand on y a une fois goûté s’imprime dans l’âme et l’on a peine à s’en affranchir. De temps en temps, quelque famille se décide à revenir vers la civilisation où elle trouvera, pense-t-elle, une vie plus facile. Mais à peine le printemps est-il de retour, que les fugitifs se sentent déracinés, la nostalgie les prend et ils déclarent ne pouvoir vivre loin de leurs habitudes accoutumées ni se mouvoir à l’aise au milieu d’une société pour laquelle ils ne sont pas faits. Un beau jour, laissant là tout ce qu’ils avaient ébauché, ils repartent pour ce Labrador tant détesté mais hors duquel ils se sentent comme un poisson hors de l’eau. ”
Vous avouerai-je que j’ai été moi-même conquis par ce pays étrange où chaque pas me révélait quelque chose d’inusité ? Si le temps me l’avait permis j’aurais volontiers prolongé mon séjour. »
Eugène Achard (1960)